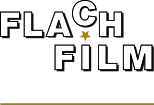Note d’intention d’Eric Barbier concernant Le Brasier
Entre film volé et film de luxe, entre court métrage et superproduction, gardant de l’un l’urgence et l’empirisme, bénéficiant des moyens de l’autre. LE BRASIER a fait son chemin sur le fil du rasoir. J’ai retrouvé la note écrite le soir de mon premier jour de repérage, à Montceau les Mines, le 17 avril 1985.Tout y est dit de ce qui m’attendait : “Visité l’après-midi quelques puits et des cités ouvrières. Tout est fermé. C’est atrocement triste la visite d’une mine déserte… Appris que je ne pourrai descendre au fond avant un mois : ça m’enrage. A 17h, rencontré M. François avec qui j’ai longtemps parlé : les gens, les dates, les problèmes syndicaux, l’arrivée de la guerre. Le sujet m’est apparu démesuré… Et la boxe ? Quelle place lui donner dans tout ça ? Je sentais que tout m’échappait, qu’avant même de commencer le travail je n’avais plus aucune idée et que j’étais condamné à laisser venir le sujet…”
Le désir d’un film est impalpable. Il surgit d’impressions : un visage, un lieu peuvent suffire à donner l’impulsion. Mais reste ensuite à forcer le réel pour obtenir qu’il délivre la fiction. Lorsque je suis reparti de Montceau avec pour tout viatique quelques images de la mine – les chevalements, la “salle des pendus” de Saint-Etienne, où nous avons tourné – je n’avais qu’une certitude pour l’histoire : qu’il y fallait une révolte, un bal et une rixe au couteau. Pendant près de six mois, j’ai couru du Nord au Centre, à la recherche de l’axe qui me permettrait d’intégrer ces éléments. J’ai forcé des dizaines de gens à raconter, raconter mais quel que soit l’intérêt des éléments qu’ils m’apportaient, leur accumulation ne faisait que rendre plus compliqué le choix de la solution.
Ces moments de choix réclament une solitude absolue, souvent désespérante. Deux personnes m’ont aidé, pourtant : Aïssa Djabri et mon père, seul à pouvoir accepter ce despotisme de l’idée fixe qui me ramenait inlassablement à mon émotion initiale.
Chaque scène, chaque personne du film a sa référence, son histoire. Pavlak est né de ma rencontre avec Walczak, un mineur ancien champion d’Europe de boxe. Mais il m’a fallu deux mois pour accepter l’idée que Pavlak ne boxait pas pour être champion. Bétaix m’a été inspiré par Claude Martin, un directeur de journal de Montceau, porté à la mairie en octobre 1934 sur un programme simple : remplacer par des “hommes propres” les “profiteurs socialistes”. Ce qui m’a captivé dans son ascension, c’est qu’elle permettait de saisir avec une précision clinique le pouvoir de cristallisation d’une parole politique nouvelle dès lors qu’elle est portée par un homme surgi de la masse. Mais autant Martin n’est encore qu’un exalté de province, autant les Bétaix d’aujourd’hui font peur, qui ne peuvent ignorer le pouvoir des forces qu’ils invoquent.
Lorsque je construisais mes personnages j’ai passé des jours et des jours à visionner des films au magnétoscope et à les analyser dans des notes que je tapais avec une espèce de rage. Au bout de trois mois, comme je ne trouvais rien, j’ai pris la décision d’adapter Germinal. J’ai consacré trois semaines à le démonter entièrement, puis à le reconstruire. Mais le roman était plein d’embûches ; l’introduction, la grève que je n’arrivais pas à raconter et l’univers industriel de la fin du 19ème qui n’autorisait pas une vision contemporaine de la mine. J’ai fini par abandonner, en ne gardant de Zola que le triangle amoureux au coeur du film et deux épisodes : la bagarre des rivaux et la broche offerte à Alice.
Lorque je suis revenu au BRASIER, tout restait à faire. C’est alors que j’ai découvert l’épisode oublié de la grève des Polonais au fond de la mine de l’Escarpelle – dont la fermeture définitive s’est fait ces jours-ci. J’ai retrouvé les actualités de l’époque, que l’on voit dans le film : l’expulsion des Polonais et de leurs familles, la vente à la criée de leur mobilier. Ce choc du réel m’a donné ce qui me faisait encore défaut : le lien entre les destins individuels et l’Histoire qui les brasse et les disperse.
Lorsque j’ai fait lire la première version du scénario à certains mineurs que j’aimais bien, je m’attendais à ce qu’ils me disent : “De quoi tu te mêles à parler de nous ?” Mais leurs réactions m’ont appris que l’histoire tenait la route. Un mot m’a particulièrement ému : celui d’Edmond, un ancien boxeur, modèle de Dalmas, qui m’a dit : “Mais tu as tout piqué !”
Le scénario achevé et les trois millions du prix Victor Hugo derrière moi, je me suis retrouvé tout benêt à faire les boutiques pour proposer une camelote dont personne ne voulait : un premier film pareil ne rentrait pas dans le système. J’ai eu la chance alors de rencontrer Jean-François Lepetit qui, du début à la fin, a su rester tout près du film en contrôlant sa “furiosité” sans jamais abuser du pouvoir que lui conférait son statut face à un réalisateur dont c’était – après tout – le premier film.
Tout était désormais réuni pour que la machine se mette en marche : le désir, le travail et l’argent. A partir de là le processus pouvait construire inéluctablement sa propre évidence et -fut-ce encore au prix de crises et de piétinements – inventer ses propres solutions. Je me contenterai d’en donner ici quelques illustrations. Dès les premiers moments, il est apparu que le budget du film serait élevé. Non par l’effet d’une fantaisie ou d’une volonté de grand spectacle, mais en raison même des exigences du sujet. La mine fonctionnant comme une machine qui se nourrit d’hommes, la filmer sans disposer de la masse qui rende sensible cette vision n’aurait eu aucun sens. Autre nécessité : celle d’aller chercher en Pologne ou en Belgique des décors déjà disparus en France et de réinventer, pour en faire un acteur à part entière de l’histoire, ce labyrinthe des galeries où peinent et s’affrontent des hommes, écrasés par le poids des ténèbres. Je pourrais multiplier les exemples : tous montreraient que l’argent investi est allé où l’histoire l’exigeait pour exister.
Les acteurs m’ont été des alliés précieux. Leur engagement est resté extraordinaire du premier au dernier jour. Personne n’a jamais considéré qu’il y avait pour chaque scène une solution miracle. Lorsqu’il est arrivé que l’idée initiale se perde en chemin, ils se sont battus comme des fous pour la retrouver. Il y a eu des moments où je n’avais plus d’idées, plus de ressort. Je m’asseyais alors à côté d’eux et nous restions là sans parler, jusqu’à ce que ça reparte.
C’est grâce à tous ceux là, qui ont eu le courage de partager ma peur, que le film s’est fait. Un nom s’impose à moi, qui vaut pour tous les autres, auxquels je pense et qui le savent : celui de Bernard Bolzinger.
Certains n’ont pas supporté l’exigence de l’entreprise et sont partis. Mais l’énergie qui nous habitait était plus forte que tout. La mine s’était remise en marche, plus rien ne pouvait l’arrêter. Et le film était indestructible.