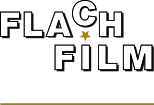Le Fou Filmant
Du cinéma peint sur pellicule au premier long métrage d’Alain Soral, en passant par la pub à gros budget aux côtés de Michel Gondry, le parcours de Jean-Louis Bompoint est des plus surprenant.
Confession d’un chef opérateur atypique.
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au cinéma ?
J’ai découvert le cinéma très jeune. A 4 ans, mon père m’a emmené voir Peter Pan (Walt Disney) en me disant avant d’entrer dans la salle que j’allais voir des images immenses qui bougeaient sur un mur. J’ai été fasciné sans comprendre le principe technique.
En 1966, j’ai été invité à l’anniversaire de l’un de mes camarades de classe. Il avait reçu en cadeau de la part de ses parents un petit projecteur de cinéma à manivelle appelé Minicinex. Cet appareil était génial : on pouvait faire défiler le film en avant, en arrière, au ralenti,en accéléré et même s’arrêter sur un photogramme de son choix. Ensuite, mon oncle, qui était cinéaste amateur, organisait des projections Familiales en prenant le temps de m’explique avec précision comment fonctionnait le principe du cinématographe. Cela m’a immédiatement passionné et j’ai décidé d’en faire ma profession.
Parallèlement à cela, ma passion pour la musique, et particulièrement le jazz, grandissait; je me suis mis à faire la relation entre le rythme des images animées du cinéma et celui de la musique : il y avait quelque chose de commun entre tout cela et des choses passionnantes à découvrir.
A partir de là, tous mes jeux d’enfant ont été basés sur la relation “image/son”. Par exemple, si je faisais du vélo, je pédalais en rythmant mon déplacement sur un air de musique que je chantais dans ma tête. Si je construisais quelque chose avec mon Meccano c’était toujours des choses mobiles, voire abstraites, et jouant des sources lumineuses que je pouvais déplacer et manipuler sur un rythme musical quel qu’il soit. En 1972, j’ai découvert le cinéaste d’animation canadien Norman Mac Laren et ses films musicaux abstraits directement peints et dessinés sur pellicule, dont Begone Pull Care (1949) avec comme bande son, une improvisation jazz du trio d’Oscar Peterson. Cela a été un véritable choc émotionnel car je trouvais là la réalisation concrète de tous mes rêves esthétiques.
Comme je désirais tourner des films mais que je n’avais pas de caméra, j’ai décidé d’adopter le procédé de Mac Laren en dessinant des images sur de la pellicule 8mm, photogramme par photogramme, sans l’aidé d’une caméra. Aprés quatre mois de travail acharné, j’ai envoyé mon petit film de 4 minutes ( soient 5 760 images dessinées à la main) à Mac Laren, afin de savoir ce qu’il pensait de mon travail (à 12 ans, on n’a peur de rien !..). Par bonheur, le cinéaste m’a répondu positivement en me demandant d’arrêter de m’esquinter les yeux sur format aussi petit et en m’envoyant de la pellicule 16 et 35 mm ainsi que de nombreuses notes technique concernant les divers procédés qu’il avait mis au point. Nous avons échangé une correspondances soutenue, pendant plusieurs années j’envoyais mes films à Mac Laren qui corrigeait et commentait aimablement mon travail. J’ai eu là une chance incroyable !
Votre passion pour le jazz a-t-elle eu une influence sur votre manière d’appréhender les films ?
En découvrant le travail de S.M.Eisenstein, j’ai lu dans ses écrits sur 1e cinéma qu’il avait déclaré: “le film est rythme“. Grâce à cela, j’avais compris que le cinéma n’était en fat nullement une question de scénario plus ou moins bien écrit mais plutôt une continuité rythmée qui devait sans cesse éveiller l’attention du spectateur.
En fait, je m’étais rendu compte que n’importe quel film racontait plus ou moins la même histoire ; que ce soit un dessin animé, un western ou un film de cape et d’épée. Seule la qualité du film, relevait de son rythme : le jeu des comédiens, leur diction, la composition des mouvements de caméra, la dynamique de la lumière, la nature de la bande son et, bien sûr, la qualité du montage. C’est pour cela, entre autres, que le cinéma de Godard m’interpelle et que celui de François Truffaut m’ennuie vraiment. Pendant de longues années, j’ai été monteur et dois avouer que si je n’avait pas été musicien, je n’aurais jamais pu résoudre tous les problèmes “image et son” qui se sont présentés sur ma table de montage. Notamment, lorsque j’ai restauré pour Gaumont, en 1990, L’Atalante (Jean Vigo, 1934). La narration comptait peu. Sûrement avant beaucoup d’autres, Vigo l’avait aussi compris. Seul le rythme doit être roi. Avec ce principe, on est certain de résoudre nombre de choses et le plus mauvais film qui soit, s’il est bien monté, peut devenir passionnant.
Et la lumière, le travail de chef opérateur ?
La prise de vues et la lumière m’ont toujours interpellé. Souvent, lorsque nous regardions des films avec Michel Gondry, celui-ci m’encourageait à devenir directeur de la photographie : “tu n’as plus rien à faire dans le dessin” me disait-il, “je suis sûr que c’est la fonction de chef opérateur qui te convient”. Cependant, je n’étais pas convaincu, quelque peu effrayé par une telle responsabilité. Mais Gondry est quelqu’un de tenace et un jour de 1997, alors qu’il avait quitté la France pour les Etats-Unis, il m’appelle d’Hollywood pour me dire : “j’ai décroché la pub Nike en tant que réalisateur et ce sera toi le chef op ! : Fais tes valises et rapplique toi”. Me voilà donc quelques jours plus tard à la tête d’une équipe technique américaine pour diriger la lumière et les prise, de vues des cinq spots Nike, orchestrés par Michel Gondry. Ce fût une sacrée expérience! Ensuite, les choses sont allées très vite. Georges Rermamn, producteur exclusif de Gondry, (Partizan-Midi Minuit) m’a conseillé de rencontrer un agent. Après quelques visites infructueuses, j’ai eu le plaisir de rencontrer Mireille Aranias et Véronique Lhébrard, son adjointe, qui m’ont accueilli avec chaleur au sein de l’agence First One.
Qu’est ce qui vous attire dans le travail en publicité ?
Faire des films de pub est absolument passionnant. Pour chaque nouveau projet, il faut s’adapter pour donner au sujet imposé tout son talent et son imagination dans un laps de temps très court.
J’ai eu beaucoup de chance dans la mesure où tous les réalisateurs qui m’ont accordé leur confiance, m’ont toujours laissé l’entière liberté de pouvoir opérer à ma guise; même si j’ai pu parfois comprendre que mes méthodes de travail, par leur non conformisme, en on surpris quelques uns…
Qu’ importe si l’on filme du fromage, un soda, une voiture ou un déodorant… Un film de pub, c’est d’abord du Cinéma et c’est toujours dans cet esprit que j’essaye de fonctionner avec mon assistant de prédilection, Thierry Trelluyer, qui me “supporte” depuis 10 ans et dont j’apprécie un peu plus chaque jour le talent, le dévouement et la patience.
Venons en au projet Confession d’un dragueur. Comment vous l’a-t-on proposé ?
Alain Soral m’a été présenté en 1990 par Christophe Vaudou, un ami alors pigiste à Paris Match. Il savait par intuition que Soral et moi devions nous rencontrer; même si nos personnalités sont totalement opposées mais, pourquoi pas, complémentaires…
J’ai tout de suite été séduit parle le culot, l’humour dévastateur et la parfaite maîtrise de la mauvaise foi provocatrice pratiqués par Soral qui sait également se révéler un être délicieux et plein de délicatesse. Lorsqu’il m’a proposé d’être le monteur de son second court métrage: Les Rameurs (Agat Films), j’ai immédiatement accepté. .Comme le film était astreint à un budget minimal, je n’ai jamais pu être payé de mon travail. Mais pour me remercier, lorsque son film fût achevé, Soral m’a offert l’ouvrage d’Henri Alekan, Des Lumières et des Ombres, avec la dédicace suivante : “À Jean-Louis Bompoint, sage comme une image. Il faut que cela change!”. Était-ce un signe du destin?… Toujours est-il que Soral caressait depuis longtemps l’idée de tourner un long métrage adapté de l’un de ses romans. Au fur et à mesure que l’idée continuait à germer dans son esprit, il me faisait parvenir son script, toujours en voie d’ amélioration (car Soral est l’un des plus pointilleux perfectionnistes que connaisse) et comme il suivait avec attention mon travail de chef opérateur, il m’a finalement demandé de prendre en charge les prises de vues et la lumière de son film. Entre cette décision et le premier tour de manivelle, plusieurs années on passé pour que le projet se concrétise. Mais Alain Soral est un homme tenace, fidèle, qui tient toujours ses promesses et lorsque Jean-François Lepetit (Flach Films) a décidé de produire Confession d’un dragueur, il m’a immédiatement imposé comme son directeur de la photographie. Avec l’aide de la Scripte, Cenzina Perrota, nous avons à trois, établi le découpage du film. Comme l’écriture de Soral est très dense, et dangereusement précise,ce fut un travail extrêmement difficile à mener à bien et de longues séances furent nécessaires avant que nous soyons satisfaits.
Avez-vous discuté de choix de styles concernant l’image du film ?
Au niveau de l’esthétique de l’image, Soral souhaitait avoir pour son long métrage des images contrastées et colorées dans un style “Nouvelle Vague” proche de Raoul Coutard, Pierre Lhomme, voire Boris Kaufman. II était également convenu que beaucoup de scènes devraient être filmées caméra à l’épaule et surtout sans l’aide du Steadycam, une machine que nous détestons cordialement tous les deux, tant la souplesse artificielle des mouvements qu’elle provoque, affaiblit considérablement la dramaturgie ainsi que la dynamique de l’image. L’action du film devait se dérouler en plein été, à Paris. Soral a donc fait un méticuleux repérage dans les moindres coins de la capitale qu’il connaît mieux que personne, en m’indiquant les ébauches des cadres qu’il comptait composer lors du tournage. Malheureusement, les aléas de la Production ont fait que nous avons commencé le tournage début octobre avec des conditions atmosphériques épouvantables.
Adieu donc, soleil et autres ombres tranchées!… Nous avons alors donné dans un style automnal et il a été décidé que deux couleurs s’opposeraient constamment : celle du personnage de Paul (Thomas Dutronc), froide et se déclinant vers le bleu contre celle de Fab (Saïd Tagmahoui), chaude et orangée.
Ce type de décision ne va pas sans une centaine collaboration avec les costumes, ou les décors…
J’ai eu la chance, sur ce film, de travailler avec une amie de longue date, Martine Bourgeon, qui a une vraie connaissance des relations entre lumière et costumes. Cette dernière a une expérience extraordinaire, notamment de quelques gros films américains, et c’est une des rares à d’abord s’entretenir avec l’opérateur avant de faire ses propositions au réalisateur. À cette occasion, j’avais d’ailleurs offert à Martine un verre de vision panchro qui permet, lorsqu’on le porte à l’oeil, d’interpréter les couleurs telles que les “voit” réelIement la pellicule. Pendant tout le film de Soral, elle a constamment utilisé cet accessoire pour choisir ses costumes, ce qui illustre bien l’interaction qu’il y avait entre nos deux postes. Il y a eu aussi, bien sûr, le même travail effectue avec Denis Mercier, le chef décorateur qui a fait des aménagements extraordinaires, notamment sur une scène se passant dans l’entrepôt d’un antiquaire, qui me faisait un peu penser à l’entrepôt de Saturnin Fabre dans Les Portes de la nuit de Marcel Carné.
N’est-ce pas plutôt inhabituel pour un opérateur comme vous qui a principalement travaillé sur des publicités internationales de se retrouver sur un film à budget très serré ?
Lu début de collaboration avec les responsables de Flach Film a été extrêmement éprouvant pour moi. La production a vu d’un très mauvais oeil que Soral impose sans conditions “un chef opérateur sorti tout droit de la pub (et qui plus est à très gros budgets) et qui n’avait jamais tourné de long métrage” (sic!!!).
Bien que correct, le budget de Confession d’un dragueur était loin d’être identique à ceux des autres films auxquels j’ai pu participer. Mais c’était oublier que je savais également travailler dans des conditions “spartiates”. Bien avant d’avoir l’opportunité de travailler sur des budgets “élyséens”, j’ai tourné de nombreux petits films, parfois même avec de la pellicule périmée et éclairée par deux ou trois loupiotes. Combien de fois avec Michel Gondry, lors de nos débuts et faute d’argent, avons-nous développé et tiré nous-mêmes, grâce à des bricolages insensés dans notre salle de bains, des mètres de pellicule que nous avions impressionnés en vue de composer tel ou tel court métrage? Également, sous l’influence du pionnier cinématographique pluridisciplinaire Julien Pappé (Magie Films), j’ai appris “à faire marcher une camera avec une ficelle et trois clous”.
Cela Soral le savait et c’est pourquoi il était confiant dans ma manière de m’adapter au cadre imposé par la production de son film.
Toujours loin d’être convaincu, Flach Films m’a fait tourner des essais avec le réalisateur et les acteurs principaux du film car il convenait de tester “le débutant”… Par chance, mes prises de vues plurent à la production et les craintes commencèrent lentement à s’évanouir pour totalement disparaître lorsqu’au fil des jours, le laboratoire GTC annonçait quotidiennement le tant attendu “RAS, tout va bien, c’est très bon… “. Ainsi, et alors qu’au départ la production m’avait alloué des moyens très restreints au niveau lumière et machinerie, j’ai pu constater avec mon chef électricien, l’incroyable Alain Payet, et CyriL Leguennec, mon chef machiniste, au fur et à mesure du tournage que la confiance s’installait et qu’Eddie Jabes, notre directeur de production, nous donnait sans sourciller des moyens de plus en plus importants pour travailler. J’en ai été très heureux et remercie encore Jean-François Lepetit de m’avoir offert la chance de pouvoir tourner mon premier long métrage français en m’ accordant peu à peu sa confiance comme son amitié qui se sont développées tout au long de ce tournage qui s’est effectué en 33 jours de marathon avec une équipe sensationnelle.
Quels ont été vos choix techniques pour le matériel de prise de vues ?
Lorsque D.W.Griffith a tourné Naissance d’une nation, il y avait mille figurants devant la caméra et seulement 3 personnes derrière. Aujourd’hui, c’est le contraire qui se passe. Aussi, j’essaye du mieux que je peux d’employer le matérielle plus léger qui soit avec le moins de monde possible.
N’oublions pas que les caméras que nous utilisons aujourd’hui ont exactement la même technologie que celle inventée par Louis Lumière aux débuts du cinéma. Seul le mouvement, autrefois entraîné manuellement, a été remplacé par un moteur électrique. Toutes les caméras actuelles, énormes et bourrées d’électronique inutile prêtent à rire mais pas tant que les affairés qui en deviennent esclaves en accordant plus d’importance à réussir “à faire tourner la bête”, plutôt que de se préoccuper de ce qu’elle va capter !
Je me bats donc toujours pour utiliser les plus petites caméras en présence sur le marché. Ainsi, I’Aäton 35 et la Moviecam SL sont mes caméras 35mm de prédilection. Pour Confession d’un dragueur, j’ai tourné tant que j’ai pu avec l’Aäton 35. Le film a été enregistré en son direct par le talentueux et exigeant ingénieur du son François de Morant. J’ai dû parfois utiliser une encombrante caméra Arriflex BL4S, totalement insonorisée et visant à se faire oublier au niveau décibels, des impitoyables microphones et grands porteurs d’ombres involontaires, que François et Emmanuel Ughetto, son assistant, plaçaient ici et là avec un diabolisme malicieux. C’est là que j’ai remarqué, que la France était peut-être le seul pays où l’on savait réellement tourner en son direct et avec une qualité sans pareille!
Question lumière, tout est bon à prendre: Tungstène, HMI, réflecteurs, etc. J’adore mélanger tout cela. Ce qu’il faut, c’est trouver la source juste pour concrétiser heureusement la prise de vues que vous allez effectuer. Je ne respecte aucune règle: cellules, colorimètres et autres engins du même acabit m’ennuient souverainement. C’est en général mon chef électro qui fait la liste des lumières. Je la demande toujours basique et sans fioriture inutiles. Suivant le plan qu’il y a à faire, je vais dans le camion, discute avec mes gars et choisis ce qui convient, toujours en ayant dans l’idée d’en utiliser le moins possible.
Et concernant la pellicule ?
La pellicule que j’utilise est presque toujours équilibrée en lumière du jour. Moins elle est sensible et plus je suis heureux. Sur ce film, j’ai panaché de la 5245 (50D), avec de la 5246 (250D) et aussi un peu de 5279 (500T) pour deux scènes (la boîte de nuit, et l’entrepôt de l’antiquaire).
Mon ouverture de prédilection est f :8. J’aime la profondeur de champ. Mon obsession ? La mise au point! Les plans flous me font horreur. Ne parlons même pas des plans mous qui sont pour moi un véritable cauchemar !
Etant donné que je cadre tous les films que je tourne, je fais la mise au point sans décamètre lorsque j’utilise une caméra à système Reflex, c’est-à-dire qui renvoie directement l’image que vous cadrez dans 1e viseur.
Lorsqu’il y a des changements de point à effectuer en cours de prise de vues, je les donne au préalable à mon assistant qui les repère et les prend en charge lorsque l’on tourne la scène. Je ne trouve rien de plus stupide que de faire la mise au point au décamètre lorsque l’on dispose d’une caméra Reflex. Mais c’est malheureusement ce qui se pratique sur tous les tournages dans 90% des cas car les équipes image sont encore sous la coupe d’une vieille habitude se pratiquant à l’époque révolue où les caméras étaient “aveugles” ; c’est-à-dire, qui ne renvoyaient pas directement à l’opérateur l’image de ce qu’ elles enregistraient pendant la prise de vue (Par exemple les caméras Mitchell à système Rackover ou les Debrie “Super Pavo”, pour ne citer qu’elles…).Moralité, regardez attentivement n’importe quel film actuel : 40 % des plans sont mous, parce que leur mise au point a été effectuée au décamètre !
Alain Soral a un sens inné du cadre. Dans la composition des prises de vues, son exigence comme son jansénisme sont dignes de Robert Bresson, qui était comme on le sait, la terreur des chefs opérateurs tant il considérait que “puisqu’il y a de la lumière, aussi faible soit elle, on peut encore tourner… “.
A ma plus grande joie, il m’a demandé parfois l’impossible en tournant dans des conditions de lumière périlleuses. Mais ces risques se sont finalement révélés payants et je remercie encore mon réalisateur de m’avoir poussé vers “cimes de l’extrême”. Seul, le résultat compte!
Revue n° 508