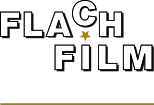interview de Marion HANSEL concernant le film Dust
C’est l’histoire d’une femme racontée par un homme. Cela m’a étonnée et fascinée parce qu’il la décrit en se mettant à distance de son corps et de ses sentiments. Filmer une femme névrosée, malade, ne m’intéressait pas à priori. Je me suis décidée à cause du regard et de l’écriture de Coetzee, sa manière de voir Magda. On est dans le poisseux, le pervers, le douloureux. C’est la sensation que m’a laissée la lecture de son livre et l’atmosphère que j’ai voulu rendre. Mon adaptation est fidèle au roman, comme toujours dans la richesse d’un texte, la magie d’un style, on est obligé de choisir, d’éliminer, de trancher. Pour tout dire, il aurait fallu faire un film fleuve. Je suis allée à l’essentiel mais en respectant la chronologie, le nombre de personnages.
Vous avez fait deux films. Tous les deux sont des adaptations. Est-ce un hasard ?
Pas vraiment. Avoir une histoire devant moi me rassure. J’ai un peu peur de me lancer dans un récit dont je ne connais pas la fin. Je ne suis pas un écrivain. Mais quand un roman me touche, je peux analyser pourquoi et savoir s’il va intéresser d’autres que moi, un public qui va au cinéma. Je ne choisis pas un livre au hasard. Il y en a des centaines d’excellents. J’en prends un qui me concerne directement, dans lequel je peux me projeter, et que je peux enrichir de mon expérience et de ma vie. Ici le rapport au père est l’élément qui m’a retenue. Je n’ai jamais vécu en Afrique, il ne s’agit donc pas pour moi d’une nostalgie d’exilée. Je n’ai jamais vécu non plus avec d’autres peuples, des noirs ou des jaunes. Ce n’est pas le rapport racial qui m’a arrêtée. Par contre mon père est très important et présent pour moi, malgré sa mort. J’ai eu envie de parler d’une passion, d’un lien de haine et d’amour entre un père et sa fille.
Vos rapports de travail avec Coetzee ont-ils été différents de ceux que vous aviez avec Dominique Rollin auteur du “Lit” ?
Avec Dominique Rollin, dès le premier jour, nous avons travaillé dans la complicité, la tendresse et la confiance. Avec Coetzee, il n’y a pas eu cette connivence. Tout a été une lutte. D’abord l’obtention des droits, puis lui prouver qu’il avait eu raison de me les donner. C’est un homme secret qui parle peu et explique encore moins. J’habite en Belgique. Lui en Afrique du Sud. Je ne l’ai rencontré que deux fois. Il m’a dit que je l’avais convaincu par ma sincérité. Je lui ai parlé de la grande admiration que j’avais eu pour son roman, de ma peur, des raisons précises et personnelles de mon choix, du film dont je voyais déjà les images. J’ai fait les quatre versions du scénario. Il en a reçu deux, m’a fait des remarques dont j’ai tenu compte. Il craignait, comme je n’étais pas sud-africaine, que je comprenne mal son pays, qu’on ne sente pas l’enracinement dans cette terre, l’importance des problèmes raciaux. Il était blessé par l’idée d’une éventuelle transposition qui en aurait fait une histoire universelle, en définitive, une histoire de nulle part.
Comment voyez-vous le personnage de Magda ?
Complexe, difficilement cernable. C’est une femme intelligente, qui analyse tout, réfléchit, ne se laisse pas aller à des impulsions. Elle est pleine de passion mais aussi de défense, d’interdit. Elle est déséquilibrée : elle oscille sans cesse entre le réel et l’imaginaire. J’ai pour elle une grande tendresse et une infinie pitié. J’ai envie de la prendre par les épaules et lui dire de se laisser aller. Le drame et la souffrance de Magda viennent de ce que son père ne la “voit” pas, ne la regarde jamais. Pour lui, elle est transparente.
Et Jane Birkin ?
Nous avons beaucoup parlé, moins de Magda et du film que d’elle. Elle m’a raconté des expériences très personnelles et en entrant dans son intimité, dans sa sensibilité, j’ai rencontré Magda. J’ai réécris de nombreuses scènes pour que cela prenne la tonalité de ce qu’elle m’avait dit. Après cela, je n’avais plus besoin de lui dire qu’elle devait marcher ou parler d’une certaine manière puisque Magda a pris ses couleurs. Elle l’a rendue plus jalouse, plus sensuelle, plus perverse, plus malheureuse d’être la mal aimée.
Comment avez-vous dirigé les autres interprètes ?
Avec Trevor Howard, mes rapports étaient parfaitement simples. On ne parlait pratiquement pas, on se souriait et on buvait. Une fois qu’il a accepté le rôle, il ne m’a plus posé que des questions de composition extérieure : est-ce que je voulais qu’il ait une barbe ou non, comment devait-il marcher ? Il s’est composé un visage, une silhouette, un costume. L’apparence mise au point, il l’habite sans jamais parler du comment et du pourquoi du personnage, mais en étant toujours juste. C’est un grand professionnel. John Matshikiza est un sud-africain exilé. Pour lui, le film et ce qu’il disait était important et dangereux. Le roman de Coetzee est ambigu. A la limite, on aurait pu en faire un film raciste. John ne me connaissait pas et ignorait mes propositions. Après trois heures de discussion, il a signé son contrat comme on signe une pétition ou un acte politique, car il a compris que “Dust” pouvait aider à la lutte anti-raciale. C’est lui qui a pris le plus de risques, je pense.
Quels problèmes de mise en scène vous a posé “Dust” ?
J’ai adapté facilement un livre pourtant difficile. Je n’ai pas eu besoin de faire appel, comme pour le “Lit”, à des scénaristes extérieurs. Tout a été très vite, et, directement j’ai vu ce que je voulais transmettre : la chaleur, la poussière, les couleurs, le désir. Je travaille toujours en prenant peu de prises. Souvent une seule suffit. Parfois deux. Mais je répète beaucoup et ma mise en place est très méticuleuse. Quand je dis “Moteur”, comédiens et techniciens savent exactement ce qu’ils doivent faire. J’ai fait un film avec 14.000 mètres de pellicule, ce qui est peu. Non par esprit d’économie ou parce que je n’en avais pas mais tout simplement parce que ma première prise est la meilleure. Peut-être que la vingtième serait meilleure, mais je n’aime pas pousser les comédiens à bout, les casser, les faire souffrir. Quand je tourne, tous les problèmes ont été résolus. Je n’ai plus de doutes. J’en ai beaucoup avant, au moment du découpage sur lequel je travaille pendant un ou deux mois avec peine et angoisse. Je dessine et décide plan après plan et mon story board reprend tous les mouvements de caméra. Axe, angle, objectif, déplacement, tout est prévu. Je remets rarement en cause ces premières données. Quand je sens qu’elles ne vont pas fonctionner je m’en rends compte et je passe la nuit à les rectifier. Les techniciens me connaissent, reçoivent des indications précises et les comédiens, j’ai toujours eu la chance de travailler avec de grands professionnels, sont vrais et forts immédiatement.
Nous parlons de mise en scène, de techniciens. Comment avez-vous travaillé avec Walter Vanden Ende ?
Dans une grande complicité. C’est le deuxième film que nous faisons ensemble. Il lit le scénario et il me demande de lui apporter toutes les données et documents que j’ai accumulés. Pour “Dust”, c’était principalement les couleurs d’un tableau de Breughel : “La danse de mort”. Je voulais que le film ait ces tons : soit vert. Dans son livre, Coetzee évoque toujours pour l’intérieur une pénombre d’un vert glauque. Walter voulais que je lui montre le plus d’exemples possibles de “mon vert” parce que c’est une couleur difficile au cinéma. Nous avons regardé ensemble beaucoup de tableaux, de photos, de films. Je voulais éviter l’exotisme, avec ciels bleus, etc. et les couleurs convenues. Pour les extérieurs, c’était le blanc qui m’intéressait. On ne voit pratiquement jamais le ciel. Il y a deux plans, je crois, où on l’aperçoit. Nous avons cadré sur la ligne d’horizon pour signaler la fermeture, l’écrasement. Magda vit dans un grand espace, mais pas dans un espace libre. Faire un film qui, pendant une heure au moins se déroule à l’extérieur sans ciel, c’est une gageure, mais Walter aime les impératifs, les contraintes.
Et Henri Morelle ?
Il était très heureux parce que dans mon scénario, s’il y a un peu de dialogues, il y a beaucoup de sons. J’ai noté autant d’indications sonores que de descriptions d’images. Dans le rapport Réel/Fantasme, il me semblait que le son avait un rôle déterminant pour signaler le décalage. Il a mis au point un imperceptible déplacement. Ce dérangement, cette tricherie doivent troubler le spectateur sans être trop explicites. Il a travaillé sur la rupture des rythmes. Par exemple quand Magda dérape, le chant des grillons n’est plus le même. On le reconnaît mais s’ajoute, insidieusement, une perturbation. Comme il n’y a pratiquement pas de musique et que les dialogues sont laconiques, son travail et l’invention et l’imagination qu’il a déployés sont essentiels.
Est-ce que vous vous occupez du montage ?
Je ne quitte pas la salle de montage. Mais d’abord je donne la matière brute, les rushes à la monteuse qui découvre seule et pour la première fois les images du film. Elle n’assiste pas au tournage. Elle déblaie, elle assemble en restant très proche du scénario. Et puis nous voyons que cela ne fonctionne pas et nous commençons à tout casser. On reconstruit le film comme on bâtit une maison, des fondations au grenier, sans se soucier du nombre de pièces prévues par le plan. L’important est que le bâtiment soit solide et beau. Qu’importe les plans de départ. Là, Suzy Rossberg m’aide énormément à me dégager de la continuité prévue. Seule c’est impossible.
Vous avez tourné en Espagne une histoire sud-africaine. Est-ce que cela ne vous a pas gênée ?
Je voulais que ce soit le bout du monde mais qu’en même temps, ce bout du monde soit l’Afrique du Sud, que les gens qui connaissent ce pays le retrouvent et que pour les autres ce soit où ils veulent. J’ai fait un voyage de repérage là-bas, et j’en suis revenue avec des centaines de photos d’extérieur, d’intérieur, d’accessoires et c’est en Espagne que j’ai trouvé un paysage et une ferme qui étaient tout à fait similaires. Dans le veld sud-africain, les fermiers sont d’origine hollandaise et sont restés très attachés à leurs origines, aux objets et aux usages de là-bas. Comme mon grand-père et mon père étaient hollandais, je suis très proche de cette sensibilité, de cette mentalité.
Voyez-vous un lien de continuité entre vos deux films et quels sont maintenant vos projets ?
“Le Lit” et “Dust” sont des huis-clos où s’affrontent des personnages qui sont maintenus là par un destin qui les révolte et auquel ils voudraient échapper. Il y a aussi, chaque fois, trois comédiens principaux, et la direction d’acteurs est très importante pour moi, peut-être parce que j’ai été comédienne. Mes mouvements de caméra, mon choix d’angles, ma manière de construire une image sont aussi très voisins dans ces deux films. Mais dans “Dust”, j’ai fait plus de gros plans. Je voulais entrer dans la tête de Magda, voir le monde avec ses yeux, retranscrire son univers. Donc je cadre sur elle, son corps et tous les êtres qu’elle observe comme avec une loupe. Le sujet du “Lit” amenait une plus grande distance, une pudeur et un recul. Maintenant tout en continuant à traiter des sujets importants et graves, je voudrais faire autre chose, aller plus loin. Je cherche un grand scénario ou un grand roman. Je lis beaucoup mais je n’arrive pas à m’arrêter à ceux qui sont anecdotiques. Je voudrais filmer une quête : un personnage qui est à la recherche de lui-même et d’un idéal. Trouver mon “Jeremiah Johnson”.
Propos recueillis par Jacqueline Aubenas