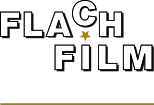Interview de Gilles de Maistre concernant KILLER KID
Avant de passer à l’acte, à quel genre de cinéma rêviez-vous ?
C’est passé par plusieurs périodes… Les maîtres français, style René Clément, et les maîtres américains contemporains : Coppola, Scorsese, Kubrick…
Tous les thèmes abordés dans vos reportages “Banlieues“, “J’ai douze ans et je fais la guerre“… sont des sujets de société qui parlent de la souffrance et particulièrement de celle des enfants. C’est le thème de Killer Kid. Pourquoi avoir choisi de poursuivre dans cette voie ?
Ça doit venir de mon parcours personnel. J’ai eu une enfance bourgeoise, protégée, dans le 16ème, école de curé, etc. Bref jusqu’à vingt ans je n’ai rien su de la vie. J’ai eu besoin d’apprendre. C’est pour ça que j’ai fait le tour du monde avec ma caméra… C’est une initiation, qui a continué avec Killer Kid. Une plongée dans la pire réalité du monde. Je ne vois pas ce que j’aurais pu raconter à vingt ans… Les vacances à Saint-Tropez ? Pour mes parents, j’allais suivre la voie royale : école de commerce, cadre sup… A l’époque j’étais révolté par rapport à ça, ma vie de reporter m’a aidé à me construire.
D’avoir été un grand témoin aide à recréer la fiction ?
Mon ambition n’est pas de faire du documentaire au cinéma, ce sont deux métiers complètement différents. Je ne pense pas qu’un vrai reporter puisse facilement faire du cinéma. Mon itinéraire n’est pas significatif. C’est un parcours de vie. Je ne me suis jamais vraiment senti journaliste, et je n’ai jamais considéré que je faisais un travail. Ce que j’ai pris du reportage pour faire du cinéma, c’est simplement ce que j’ai vécu. Ni une technique, ni un job, ni une façon de faire. Juste des émotions inscrites en moi… Avec le cinéma, je suis reparti à zéro. J’ai découvert un métier qui était l’opposé de celui que je pratiquais. Reporter, j’étais seul avec ma caméra, je la mettais en scène par rapport à la réalité, là il a fallu tout réinventer. Quant au travail avec le comédien, j’avais eu affaire, jusque là, à des gens qui vivaient leur vie… je n’avais pas à les diriger ! Alors j’ai travaillé dans des ateliers de mise en scène, de comédiens, j’avais une petite familiarité avec ce travail pour avoir, plus jeune, fait du théâtre. Et puis est arrivé le premier jour de tournage. Un petite tension bien sûr, une sorte d’angoisse, mais surtout un rêve qui se réalise.
Le thème de l’enfance malheureuse est récurrent dans vos reportages. Votre premier film en parle aussi. Hasard ou nécessité ?
C’est un concours de circonstances, il n’y a pas de hasard dans la vie. Je m’intéresse à l’enfance pour beaucoup de raisons, et sans doute que c’est aussi un retour sur la mienne… Les enfants sont passionnants à filmer parce qu’ils ménagent toujours des surprises. Quand j’ai commencé à faire mes reportages, on parlait peu de leur souffrance. Pendant des années toute cette violence dont j’ai été le témoin m’a tellement imprégné qu’il était logique que je tombe sur une histoire qui lui fasse écho. Quand je suis tombé sur le livre de Claude Klotz, je finissais “Banlieue” et démarrais “J’ai douze ans et je fais la guerre“. J’avais tourné dans une cité à Gennevilliers et je prenais l’avion pour aller en Israël filmer les petits Palestiniens de Gaza et des territoires occupés. A l’aéroport, j’ai acheté ce bouquin “Killer Kid“. Ce livre démarre dans les camps palestiniens et finit à Gennevilliers. C’était un signe. Claude Klotz connaissait mes reportages, il a trouvé que j’étais la personne qui pouvait filmer cette histoire. Il nous a beaucoup aidé, notamment au niveau des droits. Par contre, il n’est pas intervenu dans l’adaptation, parce qu’il n’aime pas retravailler ses récits. Et puis je souhaitais faire une adaptation très libre.
Le film a-t-il été difficile à monter ?
Oui et non, Jean Drucker m’a toujours soutenu et encouragé. Ça a quand même pris quatre ans ! On me dit que ce n’est pas beaucoup pour un premier film, moi ça m’a paru relativement long ! Sur ces quatre ans, si l’on concentre un peu le travail réalisé, il y a beaucoup d’attente. Concrètement, il y a trois/quatre mois pour l’écriture du scénario, deux mois de préparation, deux mois de tournage et trois mois de montage ! J’ai eu le temps parallèlement à ça de faire sept fois 52 minutes pour la télé!
Avez-vous rencontré des difficultés particulières avec les deux jeunes comédiens ?
Il a d’abord fallu les trouver ! On a vu des centaines de mômes. Comme pour mes reportages j’ai vraiment fonctionné au coup de foudre. On a fait tous les essais habituels mais je dois dire que quand j’ai vu Teufik et Younesse j’ai su que c’était eux. Je choisis toujours les mômes que je vais filmer à l’instinct. J’ai travaillé avec eux dans mon atelier de mise en scène, et avec Pascal Luneau, un coach qui fait travailler pas mal d’acteurs (notamment Anne Parillaud pour Nikita). A quatre, nous avons exploré à fond le scénario, les dialogues et les situations. Arrivés sur le tournage, les gosses avaient complètement intégré le scénario.
Avez-vous rencontré des difficultés liées au thème politique du film ?
Non, les gens ont bien compris qu’il ne s’agissait ni de parler du Proche-Orient, ni des Palestiniens, ni du Hezbollah, ni du terrorisme… Ce n’est que le contexte du film, sans plus. Mon projet était de parler des enfants, de l’enfance broyée par les adultes. Pour moi ce n’est pas du tout un film politique. Il y a dans le monde, et je suis bien placé pour le savoir, des millions et peut-être même des dizaines de millions d’enfants à qui on fait porter des choses qui ne sont pas de leur âge. Les enfants qui travaillent, les enfants qui font la guerre, les enfants en prison… C’est cet aspect de l’humanité, cet aspect de mon époque qui IMPOSE aux enfants. Au-delà de ça, le film est plus une métaphore sur le face à face adultes-enfants. L’histoire que je raconte est surtout celle d’un enfant manipulé qui redevient un enfant.
Avez-vous envisagé un moment de faire jouer le rôle du petit terroriste à un enfant venu de la guerre ?
Les connaissant bien, je ne me suis même pas posé la question. C’est pratiquement impossible. J’ai eu une expérience avec un gamin de Belfast que j’ai fait venir une semaine chez moi. Cela a été un cauchemar. Il nous a fait la guerre pendant dix jours. Cette aventure m’a fait comprendre qu’on ne peut pas sortir ces gosses de leur contexte pour leur faire faire du cinéma ! C’est trop futile ! Et puis encore une fois c’est une fiction. Quand on a besoin d’un chauffeur de taxi ou d’un flic, on ne va pas le chercher dans la rue ou dans un commissariat. Pour les enfants c’est pareil. Bien sûr le travail a été difficile parce que ce n’est pas évident pour un môme d’intégrer la personnalité d’un enfant qui vit dans la guerre et y participe. Mais le travail a porté. Quand je vois le film, c’est le même gosse que j’ai rencontré au Cambodge ou en Colombie. Ce qui m’a le plus troublé, choqué, fasciné chez les enfants-soldats c’est leur regard. Teufik dans le film a ce regard, un drôle de regard, double. A la fois une froideur, un vide, une absence mais au fond une énorme détresse. Un regard sans vie. Et pourtant quand tu tends la main à ce gosse tu sens que ça peut repartir. C’est ce qui est fabuleux chez eux, rien n’est jamais perdu, alors que chez les adultes, si.