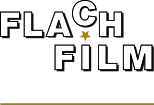Entretien avec William Karel
J’ai lu le premier livre d’Éric Laurent, La Guerre des Bush, lorsque je faisais mon précédent film sur la CIA [CIA, guerres secrètes, diffusé sur Arte]. Je venais de terminer le tournage et j’entrais en montage au moment de sa parution. Je l’ai trouvé passionnant. Au point que je suis même retourné voir l’un des témoins que j’avais interrogés, parce que j’avais appris des éléments nouveaux sur lui. Après le film, j’ai lu le second livre, Le Monde secret de Bush, avec toujours le même intérêt. Et, un matin, Jean-François Lepetit et Agnès Vicariot m’ont appelé pour me dire qu’ils venaient d’acheter les droits et me proposer d’en faire l’adaptation. CIA, guerres secrètes était mon septième documentaire sur les États-Unis, alors je m’étais dit que je commençais à avoir un peu fait le tour de la question… En même temps, ça devenait pour moi comme un feuilleton dont je voulais connaître la suite. Le film a été diffusé au tout début de la guerre en Irak et j’avais très envie de retourner aux États-Unis voir comment les choses évoluaient là-bas. Alors, j’ai accepté.
Ce n’était pas vraiment possible. Il est beaucoup plus facile d’entrer en contact avec les gens quand on travaille pour la presse écrite. D’abord à cause de la réputation d’un journal (dans le cas d’Éric Laurent, c’était Le Figaro) mais surtout parce qu’on peut les citer sous le couvert de l’anonymat, ce qui est évidemment impossible à la télévision. D’autant que j’ai l’habitude de faire des films qui utilisent des témoignages directs, car je traite de sujets déjà historiques et que les témoins n’ont en général plus de devoir de réserve. Là, on était dans l’actualité immédiate, alors il y a eu tout de suite un certain barrage.Ce qui fait que votre film privilégie les témoignages extrêmement critiques…
C’est vrai, des gens comme Stanley Hoffmann ou Norman Mailer n’ont pas une grande estime pour les Bush, voire les détestent carrément. Il y a aussi ce qu’on peut appeler des « dissidents », comme David Kay ou Joe Wilson, qui ont travaillé pour l’administration de Georges W. Bush mais ont quitté son service. Quant à ceux qui soutiennent Bush et la guerre en Irak, ils ont pratiquement tous refusé de participer. Nous avons essayé vingt fois d’approcher Paul Wolfowitz, à chaque fois on nous a envoyé promener. Je ne vous parle même pas de Bush père… Le pire, c’est Dick Cheney : il est impossible d’approcher qui que ce soit de son entourage.
Et quant aux rares qui ont accepté…
Nous avons obtenu le témoignage de Richard Perle parce que je le connaissais depuis mon précédent film et qu’il a une maison en France, mais surtout parce qu’il n’a plus aucune fonction officielle. Le seul membre « officiel » de l’entourage de Bush qui ait accepté de nous répondre est David Frum, auteur des discours présidentiels et « inventeur » de la formule d’« axe du mal ». Pour d’autres témoins, c’était plus compliqué. Frank Carlucci voulait bien parler mais pas de tout. Hors de question de dire un mot des liens entre Saddam Hussein et Bush père, il était même horrifié qu’on puisse aborder le sujet. Michael Ledeen, ancien conseiller de Reagan, était dans une position plus ambiguë. Il demeure fidèle à Bush père mais n’a pas de sympathie particulière pour son fils. Il voulait bien évoquer du bout des lèvres les armes de destruction massive mais il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Imaginez : si jamais Bush fils les trouve, il devra expliquer que c’est son propre père qui les a fournies à l’Irak quand il était au pouvoir !
Votre précédent film, Opération Lune, qui relevait surtout de la plaisanterie, a été vu par certains comme une charge anti-américaine. Là, vous aggravez votre cas…
Même si je ne livre jamais directement mon point de vue personnel, il est difficile de rester objectif sur un tel sujet, et d’ailleurs, je ne crois pas beaucoup à l’objectivité en matière de documentaire. Je ne peux pas cacher mon antipathie pour les Bush et pour leur entourage, pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
On peut vous rétorquer que ce ne sont pas eux qui ont mis en place le système dont ils profitent, notamment cette collusion entre le politique et le complexe militaro-industriel. À l’époque des Nixon, des Kissinger, etc., ce n’était guère mieux…
C’est vrai. D’ailleurs, Eisenhower, lors de son discours d’adieu, mettait déjà en garde les Américains contre les dangers que faisait courir à la démocratie la montée de ce complexe militaro-industriel. Mais ce qui a changé, c’est d’abord la place du président. Nixon était un manipulateur sans scrupules, certes, mais c’était surtout un homme très intelligent, qui participait à toutes les décisions prises à la Maison Blanche, qui n’était jamais dépassé par ses conseillers. Quand George W. Bush affirme, ces derniers jours, qu’il n’a pas été informé des cas de torture à la prison d’Abou Ghraib, le pire, c’est que je le crois ! Ce type n’est au courant de rien, la plupart des décisions passent au-dessus de sa tête. Nixon était capable de travailler 23 heures sur 24, lui, il fait des siestes de 5 heures en pleine guerre ! Ce qui est totalement inédit, c’est aussi le poids et l’influence de l’entourage présidentiel. Quand on pense que Bush père siège au conseil d’administration de Carlyle et donc vend indirectement des chars et des missiles au Pentagone destinés à la guerre de son fils ! Que la femme de Cheney est chez Lockheed-Martin, qui vend du matériel militaire à son mari ! Que Cheney lui-même contribue à enrichir Halliburton, dont il a été le PDG ! On croit rêver ! Ces gens font des profits par tous les moyens possibles, sans aucune morale et en toute impunité. C’est pour illustrer cet aspect que je voulais évoquer le conseil d’administration du groupe Carlyle, auquel assistait un membre de la famille Ben Laden, le matin du 11 septembre 2001. En soi, ça ne représente pas grand-chose mais symboliquement, c’est un bon résumé de la situation : au moment où son frère faisait se fracasser deux avions contre les Twin Towers, Shafiq Ben Laden était tranquillement en train de discuter affaire au côté de George Bush Sr.
Tout de même, huit films sur les États-Unis, et pas sur leurs côtés les plus glorieux… Vous avez un problème avec ce pays ?
Eh bien non (rires). J’aime beaucoup ce pays. À cause de ce qu’il a représenté pour les gens de ma génération : un modèle, la source de tous les mouvements d’émancipation et de contestation. Mais aussi parce qu’il est très agréable d’y travailler. Quand je faisais mon film sur les années Giscard [VGE, le théâtre du pouvoir, diffusé sur France 3], c’était un véritable cauchemar d’obtenir des entretiens au sujet d’événements qui ont eu lieu il y a 30 ans ! Aux États-Unis, une fois que les gens ont quitté leur fonction, ils parlent sans aucun problème. Le directeur du FBI qui apparaît dans mon film sur la CIA quittait son poste un vendredi soir. Le samedi, à midi, on commençait l’interview ! Pour les anciens agents de la CIA, c’était un peu plus compliqué parce qu’une loi leur interdit d’écrire même une ligne sans la faire valider par l’Agence. Mais il y a un vide juridique concernant les interviews télé dans lequel ils s’engouffrent. Quand j’allais voir les hommes qui avaient été chargés de préparer l’assassinat de Castro, ils commençaient par me dire « Vraiment, ça vous intéresse encore, ces vieilles histoires ?! », puis, ils racontaient.
En plus de ça, j’adore la politique américaine. Je lis beaucoup, je rassemble de la documentation. Quand on a une autorisation pour rentrer à la Maison Blanche, un badge de 24 heures pour se balader au Pentagone, c’est magnifique. Au moment où je tournais Les Hommes de la Maison Blanche, Clinton venait juste d’arriver au pouvoir, donc il n’entrait pas dans le cadre du film. Mais l’attaché de presse nous a proposé de le suivre pendant une journée… J’ai tout lâché pour y aller. Pour le simple plaisir d’être dans les escortes, de voir comment tout ça fonctionne… Une fascination de gamin.
Donc, malgré tout, vous ne désespérez pas des États-Unis…
Lorsque je considère ce qui est en train de se passer dans la société américaine, du retour aux « vraies valeurs » au film de Mel Gibson, en passant par l’affaire du sein de Janet Jackson, le bannissement du direct à la télé, le limogeage de certains journalistes, le Patriot Act, le soutien indéfectible à Sharon, qui pousse Israël au suicide, etc., je ne peux qu’être affligé, parce que j’y vois un retour en arrière. Mais, par ailleurs, il y a cette manifestation d’un million de femmes qui protestaient contre la modification de la loi sur l’avortement, il y a les films de Michael Moore, il y a le sénateur Robert Byrd, ce type de 85 ans qu’on croirait sorti d’un film de John Ford et qui a prononcé un discours extrêmement violent contre le gouvernement Bush… Je me dis que tout le monde ne dort pas.
Qu’est-ce qu’un film comme le vôtre peut changer ?
Rien. Dans CIA, guerres secrètes, il était question de ce fameux rapport du 6 août envoyé par l’Agence à George W. Bush pour l’avertir de l’imminence d’un attentat terroriste. J’ai rencontré deux directeurs de la CIA qui me l’ont montré – du moins hors entretien, parce qu’il leur était impossible d’en parler –, j’ai utilisé cet élément dans le commentaire, en donnant la date, en montrant la première page, en interrogeant un agent qui l’avait eu sous les yeux… Tout ça devait bien durer 4 minutes, et Arte diffusait ce film à 20 heures 40. Eh bien, c’est passé totalement inaperçu ! Un an plus tard, Le Monde faisait sa manchette en disant « Il paraît qu’il y a un rapport… » ça me met très en colère mais, au fond, j’ai perdu mes illusions lorsque j’ai fait Histoire d’une extrême droite, où je retraçais l’ascension de Le Pen. Parmi les lettres que j’ai reçues, la plupart d’insultes, il y en avait une où une femme me félicitait en disant « Merci de m’avoir ouvert les yeux. Je militais depuis 15 ans pour Le Pen. Je viens de rejoindre Bruno Mégret ! » (rires).
Propos recueillis par Christophe Kechroud-Gibassier