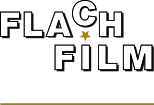ABUS DE FAIBLESSE : NOTE D’INTENTION DE CATHERINE BREILLAT
L’Abus de Faiblesse est une qualification pénale. J’en ai fait le titre du film, parce que je le trouve beau, mais aussi qu’il a un autre sens. L’abus de force.
Oui Maud a une force de caractère. Paradoxalement, c’est sa faiblesse. Le fait d’être artiste c’est aussi dévoiler aux autres ses propres faiblesses. Je n’aurais pas voulu que Maud soit metteur en scène. Et que cela puisse apparaitre comme une autobiographie. Mais après tout, toute oeuvre est une autobiographie. Puisque le spectateur, lui-même (du moins dans les films intimistes : les miens le sont) se regarde en miroir.
Le regard du spectateur est autobiographique. Il se glisse à la place des héros de fiction. Cette place pour moi, c’est le silence ou l’enfance. Je veux faire ce film comme un retour à l’enfance.
Cet abus de faiblesse commence à l’hôpital. Ce drame, la soudaine hémiplégie qui fond en une nuit sur elle, la laisse entière d’âme : adulte. C’est après que le glissement se passe. Qu’on le comprenne bien : la rééducation, je ne veux pas que ce soit l’école du courage, mais l’enfance avouée. Mais c’est adolescente, qu’elle rentre chez elle. Parce que l’adolescence est un non-lieu où on n’est ni soi, ni ce qu’on va devenir. Je l’ai voulue metteur-en scène parce qu’il y a cette atmosphère de jeu constant et cette tyrannie. Implacable mais pas adulte.
Vilko : elle le voit, elle le veut. Il faut que son assistant le trouve. Il faut que Maud aille le chercher volontairement qu’elle ne le voit d’emblée que comme « son » acteur. Vilko n’est pas une personne mais une imaginaire possession. Je ne le veux, sauf à la fin, diabolique : Et encore est-il pris dans l’autodestruction du récidiviste.
Possession, il prendra d’elle mais, elle, de lui. Un sérial, c’est un être qui n’est personne et qui n’existe que dans la prédation. C’est une pulsion obligatoire, un vertige.
Ce film, je le veux comme un vertige, une chute à deux mais comme au ralenti. Parce que le vertige c’est la peur de la chute et si on a un peu d’orgueil, on préfère précipiter la chute que d’endurer la peur. C’est une histoire d’orgueilleux.
Maud et Vilko sont dans le fond très semblables. Je ne veux pas qu’il soit calculateur ni prédateur dès le début. Lui, c’est une enfance et une jeunesse dévastée. Elle, un corps détruit. Mais ce n’est pas non plus, une tragédie qui est arrivée à Maud.
Je ne veux pas que ce soit l’école du courage d’apprendre à remarcher. Je le sais moi qu’il n’y en a aucun. C’est comme ça : un jour on se couche comme vous et le lendemain, on se réveille comme Maud. Et ce n’est pas cela que je veux raconter. Mais un inéluctable retour à l’enfance.
Parce qu’immédiatement ce corps devient le travail des autres. C’est aussi un corps qui est porté, dont on s’occupe comme celui d’un bébé. Sa chambre dans son hôpital avec son lit à barreaux, c’est celui où son producteur l’étreint. Ce n’est pas triste. C’est un état des choses où la tendresse se voit : elle prend corps.
Il n’y a pas de compassion. Je ne veux pas que le spectateur en ait. Mais qu’il plonge presque dans la douceur de redevenir enfant avec ses rapports qui s’instaurent si naturellement. Parce que c’est cela qui se joue tout au long de cette histoire.
Justement cette enfance où tous les rapports avec Maud et les autres sont obligatoirement pervertis parce qu’il y a ce rapprochement des corps. Le corps infirme, c’est celui aussi dont Vilko s’occupera. Ce n’est pas normal, mais ce n’est pas non plus pervers. Lui, ne le sera finalement presque jamais. Ce qui compte c’est ce dérapage d’affection obligatoire du corps sain. Celui du corps qui se porte bien et qui porte le corps détruit.
Qu’importe la réalité puisque ce n’est qu’un jeu d’enfance. Ils sont deux perdus chacun dans l’orphelinat de la vie. Pour des raisons différentes… Incarcération dans l’âme… Incarcération dans son corps.
Bien sûr, il y a cette duplicité implacable et cynique de l’escroc. Le spectateur ne peut que le savoir dans une déduction matérielle. Pourtant, je désire qu’il soit toujours hanté par la crainte, non de la situation de désastre financier dans laquelle Maud s’enfonce, mais que cette bulle fragile de naïveté et malgré tout de poésie réciproque, n’éclate.
C’est un thriller du déni. « Vivons un rêve » comme le dit Sacha Guitry. Céder au vertige, c’est prendre le pas dessus, rompre par la chute délibérée dans l’abîme, la peur avilissante d’y tomber. Ce vertige nous habite tous. Maud et Vilko, plus que les autres, c’est tout. Et encore, qui plonge si sciemment dans l’âme du spectateur ? C’est toujours la nôtre qu’on lui montre comme la sienne.
Ce film que je veux faire, l’histoire en est écrite dans le scénario. Pourtant, il n’est que fallacieux de la comprendre ainsi. Parce que la lecture des scripts est linéaire : lieu, temps, jour ou nuit, dialogue. C’est toujours ce qui ne « se dit pas » et ce que je ne me dis pas que je filme. L’inter-dit. Dit au spectateur, pas à moi-même.
Non pas parce que le cinéma maintenant peut être en quatre dimensions mais parce que, sa plus importante dimension est pour moi l’indicible vertige de l’âme. Ces situations où tous les mots sont vrais et où quelque chose des corps crie le contraire.
J’ai toujours dit que le cinéma c’était l’idéogramme. Deux sens de l’histoire, séparés, chacun inscrit l’un dans l’autre pour en créer un troisième qui devient l’évidence. C’est pour cette évidence-là, l’incarnation de corps, si différents bien sûr de ceux auxquels vous avez immanquablement pensés. Moi et Monsieur Rocancourt. Ces deux-là n’ont plus d’importance.
Ce n’est qu’un fait divers pitoyablement vulgarisé. L’Abus de faiblesse, ce n’est pas ça. C’est bien plus incroyable… et « délicieux ».
Catherine Breillat